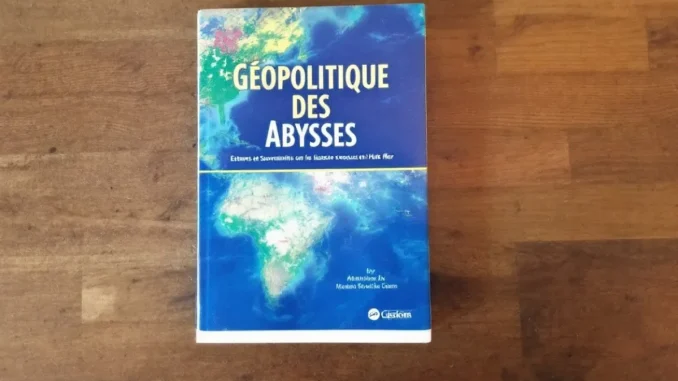
La haute mer, représentant près de 64% de la surface des océans, constitue un territoire où s’affrontent des intérêts stratégiques, économiques et environnementaux majeurs. Longtemps considérée comme un espace de liberté échappant aux juridictions nationales, elle fait aujourd’hui l’objet d’une course aux ressources sans précédent. L’adoption en juin 2023 du traité sur la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ) marque un tournant dans la gouvernance de ces espaces. Entre revendications souverainistes, préoccupations écologiques et innovations juridiques, la question de la souveraineté sur les ressources en haute mer redessine les contours du droit international maritime et cristallise les tensions entre puissances mondiales.
Cadre juridique international de la haute mer : entre liberté et régulation
La haute mer se définit juridiquement comme l’ensemble des espaces marins situés au-delà des zones de juridiction nationale, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, dite Convention de Montego Bay. Ce texte fondamental consacre le principe de liberté en haute mer, englobant la liberté de navigation, de survol, de pêche, de recherche scientifique et de pose de câbles et pipelines sous-marins.
Le régime juridique des ressources marines en haute mer repose sur une distinction fondamentale. D’un côté, les ressources halieutiques relèvent du principe de liberté de pêche, tempéré par l’obligation de coopération entre États pour leur conservation. De l’autre, les ressources minérales des fonds marins au-delà des plateaux continentaux sont soumises au statut de « patrimoine commun de l’humanité », géré par l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM).
Cette architecture juridique, fruit d’un compromis historique entre puissances maritimes traditionnelles et pays en développement, présente aujourd’hui de nombreuses failles. L’absence de mécanisme contraignant pour la protection de la biodiversité marine a longtemps constitué une lacune majeure, partiellement comblée par l’adoption récente du traité BBNJ.
Le traité BBNJ : une avancée majeure
Après plus de quinze ans de négociations, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 2023 un instrument juridiquement contraignant relatif à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones au-delà des juridictions nationales. Ce traité historique instaure un cadre pour la création d’aires marines protégées en haute mer et établit des principes pour le partage des bénéfices issus de l’exploitation des ressources génétiques marines.
Toutefois, la mise en œuvre effective de ce traité demeure incertaine. Les mécanismes institutionnels restent à préciser, et certaines puissances maritimes, notamment les États-Unis qui n’ont jamais ratifié la CNUDM, maintiennent une position ambiguë.
- Principe de liberté en haute mer (navigation, pêche, recherche)
- Statut de patrimoine commun de l’humanité pour les ressources minérales des grands fonds
- Traité BBNJ pour la protection de la biodiversité marine
- Tensions persistantes entre appropriation des ressources et préservation environnementale
La fragmentation du droit applicable aux ressources marines reflète la difficulté à concilier des intérêts divergents. Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) tentent de réguler l’exploitation des stocks halieutiques, tandis que l’AIFM élabore progressivement un code minier pour encadrer l’exploitation des nodules polymétalliques, sulfures hydrothermaux et autres ressources minérales des grands fonds.
La ruée vers l’or bleu : convoitises et stratégies nationales
Face à l’épuisement des ressources terrestres et au développement de technologies permettant l’exploration et l’exploitation des grands fonds marins, les États déploient des stratégies de plus en plus affirmées pour s’assurer l’accès aux richesses de la haute mer. Cette nouvelle « ruée vers l’or bleu » se manifeste de diverses manières, allant des revendications d’extension des plateaux continentaux aux investissements massifs dans les technologies sous-marines.
Les ressources convoitées sont multiples et stratégiques. Les nodules polymétalliques regorgent de métaux rares indispensables à la transition énergétique (cobalt, nickel, cuivre, terres rares). Les ressources génétiques marines, issues d’organismes vivant dans des conditions extrêmes, présentent un potentiel considérable pour les industries pharmaceutique, cosmétique et biotechnologique. Sans oublier les ressources halieutiques, dont l’exploitation intensive menace déjà la durabilité des écosystèmes marins.
Les stratégies nationales reflètent des positionnements géopolitiques distincts. La Chine, devenue en quelques décennies une puissance maritime de premier plan, multiplie les permis d’exploration auprès de l’AIFM et développe des technologies d’exploitation des grands fonds. La Russie poursuit une politique d’extension maximale de son plateau continental arctique. Les États-Unis, bien que non partie à la CNUDM, défendent une interprétation extensive de la liberté d’exploration et d’exploitation.
Le cas emblématique de l’Arctique
L’Arctique constitue un laboratoire des tensions autour de la souveraineté maritime. Le recul des glaces, conséquence du réchauffement climatique, ouvre l’accès à des ressources jusqu’alors inaccessibles et à de nouvelles routes maritimes. Les revendications territoriales s’y multiplient, comme l’illustre le dépôt par la Russie en 2021 d’une demande d’extension de son plateau continental jusqu’au pôle Nord.
Ces stratégies d’appropriation s’accompagnent de discours justificatifs oscillant entre affirmation de droits historiques, impératifs de sécurité nationale et promesses de gestion responsable. Elles suscitent des tensions croissantes, notamment dans des zones contestées comme la mer de Chine méridionale ou l’océan Austral entourant l’Antarctique.
La course aux ressources marines s’intensifie avec le développement de technologies d’exploration et d’exploitation toujours plus sophistiquées. Les investissements dans les véhicules sous-marins autonomes, les systèmes de collecte de nodules ou les plateformes de forage en eaux profondes dessinent une géographie de l’innovation où dominent quelques puissances technologiques. Cette asymétrie technologique renforce les inégalités d’accès aux ressources et questionne la notion même de « patrimoine commun de l’humanité ».
Ressources minérales des grands fonds : enjeux économiques et environnementaux
Les fonds marins internationaux recèlent des richesses minérales considérables dont l’exploitation commerciale semble désormais à portée de main. Trois types de gisements concentrent les convoitises : les nodules polymétalliques, concrétions riches en manganèse, nickel, cuivre et cobalt disséminées sur les plaines abyssales ; les encroûtements cobaltifères qui tapissent les flancs des monts sous-marins ; et les sulfures hydrothermaux formés autour des sources hydrothermales.
La valeur économique de ces ressources est considérable. Selon les estimations de la Banque mondiale, la demande mondiale de métaux comme le cobalt pourrait être multipliée par six d’ici 2050 sous l’effet de la transition énergétique et de la numérisation de l’économie. Les nodules polymétalliques de la seule zone de Clarion-Clipperton dans le Pacifique contiendraient plus de cobalt que toutes les réserves terrestres connues.
L’encadrement juridique de l’exploitation minière des grands fonds relève de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), organisation intergouvernementale créée par la CNUDM. L’AIFM a délivré 31 contrats d’exploration à divers États et entreprises, couvrant plus de 1,5 million de kilomètres carrés d’océan. Elle travaille actuellement à l’élaboration d’un code minier qui définira les conditions d’exploitation commerciale.
Controverses autour de l’exploitation minière sous-marine
L’exploitation minière des grands fonds suscite de vives controverses. Ses promoteurs y voient une solution aux pénuries de métaux stratégiques et une alternative moins dommageable que l’exploitation minière terrestre. Ses détracteurs, dont de nombreuses organisations non gouvernementales comme Greenpeace ou la Deep Sea Conservation Coalition, alertent sur les risques environnementaux irréversibles.
Les écosystèmes abyssaux, encore largement méconnus, présentent une biodiversité unique adaptée à des conditions extrêmes. Leur destruction pourrait entraîner la disparition d’espèces avant même leur découverte et perturber des cycles biogéochimiques essentiels. Face à ces risques, plusieurs États comme la France et des entreprises comme BMW ou Google ont appelé à un moratoire sur l’exploitation minière sous-marine, rejoints par le Parlement européen qui s’est prononcé en faveur d’une telle mesure en 2021.
- Incertitudes scientifiques sur les impacts environnementaux
- Absence de technologies éprouvées pour minimiser les dommages
- Questions sur le partage équitable des bénéfices
- Tension entre impératifs de transition énergétique et préservation des écosystèmes
Le débat sur l’exploitation minière des grands fonds illustre parfaitement la tension entre valorisation économique et protection environnementale qui traverse toute la question de la souveraineté sur les ressources en haute mer. Il révèle la difficulté à appliquer concrètement le concept de « patrimoine commun de l’humanité » et à déterminer qui peut légitimement décider du sort de ces ressources.
Ressources génétiques marines : frontière de la bioéconomie bleue
Les ressources génétiques marines (RGM) constituent une frontière prometteuse de l’innovation biotechnologique. Ces ressources comprennent le matériel génétique d’origine marine ayant une valeur réelle ou potentielle, notamment les gènes, protéines et métabolites d’organismes vivant dans des conditions extrêmes de température, pression ou chimie.
Le potentiel économique des RGM est considérable. Des applications commerciales existent déjà dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et industriel. Par exemple, la GFP (Green Fluorescent Protein), découverte chez une méduse et récompensée par le prix Nobel de chimie en 2008, est devenue un outil fondamental en recherche biomédicale. L’enzyme Taq polymérase, isolée d’une bactérie thermophile marine, constitue la base de la technique PCR utilisée mondialement pour l’amplification d’ADN.
Contrairement aux ressources minérales, les RGM n’étaient pas explicitement mentionnées dans la CNUDM. Cette lacune juridique a longtemps favorisé une appropriation privée des bénéfices issus de leur exploitation, principalement par des entreprises biotechnologiques de pays développés. Le traité BBNJ vient combler ce vide en établissant un mécanisme de partage des avantages et une obligation de transparence sur l’origine des ressources utilisées.
Bioprospection et justice distributive
La bioprospection marine, activité de recherche et collecte d’échantillons biologiques en vue d’applications commerciales, soulève d’épineuses questions de justice distributive. Qui doit bénéficier des retombées économiques issues de l’exploitation de ressources situées dans des espaces communs? Comment garantir un accès équitable à ces ressources pour les pays en développement disposant de capacités scientifiques et technologiques limitées?
Le débat oppose schématiquement deux visions. D’un côté, les pays industrialisés, leaders en biotechnologie marine, défendent un régime de liberté d’accès et de protection de la propriété intellectuelle. De l’autre, le G77 et la Chine militent pour l’application aux RGM du statut de patrimoine commun de l’humanité, impliquant un partage obligatoire des bénéfices.
Le traité BBNJ représente un compromis entre ces positions. Il établit un système de notification pour l’accès aux RGM et prévoit un partage des avantages monétaires et non monétaires, comme le transfert de technologies et le renforcement des capacités scientifiques. Toutefois, son articulation avec les régimes existants de propriété intellectuelle reste à préciser.
Cette question s’inscrit dans un contexte plus large de « biopiraterie », terme désignant l’appropriation illégitime de ressources biologiques et de savoirs traditionnels associés. Si la haute mer ne comporte pas de populations autochtones, elle n’échappe pas aux dynamiques d’inégalité Nord-Sud qui caractérisent l’exploitation des ressources naturelles à l’échelle globale.
Vers une gouvernance polycentrique des communs océaniques
Face aux limites du cadre juridique actuel et à l’intensification des pressions sur les ressources marines, de nouveaux modèles de gouvernance émergent. Ces approches, qualifiées de polycentriques, reconnaissent la multiplicité des acteurs légitimes et des échelles pertinentes pour gérer les communs océaniques.
L’approche classique fondée sur la souveraineté étatique et les organisations internationales montre ses limites. La tragédie des communs, théorisée par Garrett Hardin, semble se concrétiser dans la surexploitation des ressources halieutiques et la dégradation des écosystèmes marins. Face à ce constat, les travaux d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie, offrent des pistes alternatives en identifiant des principes de conception institutionnelle pour une gestion durable des ressources communes.
La gouvernance polycentrique se caractérise par une diversité d’arrangements institutionnels opérant à différentes échelles et impliquant multiples acteurs. Dans le contexte maritime, elle se traduit par l’émergence d’initiatives hybrides associant États, organisations internationales, entreprises, communautés scientifiques et organisations de la société civile.
Innovations institutionnelles et initiatives privées
Les aires marines protégées (AMP) en haute mer constituent une innovation institutionnelle majeure. Bien que juridiquement complexes à établir en l’absence de souveraineté territoriale, elles se multiplient sous l’impulsion de coalitions d’acteurs. La création en 2016 de l’AMP de la mer de Ross en Antarctique, couvrant 1,55 million de km², illustre le potentiel de cette approche.
Le secteur privé développe ses propres mécanismes de régulation, comme les certifications de pêche durable promues par le Marine Stewardship Council. Ces initiatives volontaires, bien qu’imparfaites, créent des incitations économiques à la préservation des ressources marines.
La diplomatie scientifique joue un rôle croissant dans la gouvernance océanique. Des programmes comme la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques (2021-2030) favorisent la production de connaissances partagées et la construction d’un consensus scientifique sur l’état des écosystèmes marins.
- Multiplication des forums de gouvernance à différentes échelles
- Émergence d’acteurs non-étatiques influents
- Développement d’outils numériques de surveillance et transparence
- Expérimentations de mécanismes innovants de financement
Ces évolutions dessinent les contours d’un nouveau paradigme de souveraineté partagée sur les ressources en haute mer. Cette souveraineté ne serait plus exclusivement territoriale et étatique, mais fonctionnelle et distribuée entre diverses entités selon leurs capacités et légitimités spécifiques.
Reconfiguration des équilibres géopolitiques maritimes
La question de la souveraineté sur les ressources en haute mer s’inscrit dans une reconfiguration plus large des équilibres géopolitiques maritimes. L’océan devient un espace de confrontation stratégique où s’affirment de nouvelles puissances et se redéfinissent les rapports de force internationaux.
L’ascension fulgurante de la Chine comme puissance maritime constitue sans doute le fait géopolitique majeur des dernières décennies. Sa stratégie d’expansion maritime, symbolisée par les nouvelles routes de la soie maritimes et une présence croissante en haute mer, bouleverse l’ordre maritime établi. Pékin a obtenu plusieurs contrats d’exploration minière auprès de l’AIFM et développe activement sa capacité de bioprospection marine.
Face à cette montée en puissance, les États-Unis réaffirment leur statut de première puissance navale mondiale et défendent une conception libérale des espaces maritimes. Leur non-ratification de la CNUDM n’empêche pas Washington de jouer un rôle central dans les négociations sur la gouvernance océanique, notamment à travers l’Indo-Pacific Strategy qui place l’océan au cœur des préoccupations stratégiques américaines.
Alliances et coalitions maritimes
Le paysage géopolitique maritime se caractérise par la formation d’alliances et de coalitions d’intérêts. Le Quad (États-Unis, Japon, Australie, Inde) se positionne comme un contrepoids à l’influence chinoise dans l’Indo-Pacifique. L’Alliance for the High Seas, coalition d’États favorables à une protection renforcée de la biodiversité marine, a joué un rôle moteur dans l’adoption du traité BBNJ.
Les petits États insulaires, particulièrement vulnérables aux changements affectant les océans, développent une diplomatie maritime active. Regroupés au sein de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), ils portent une vision alternative de la gouvernance océanique centrée sur la durabilité et l’adaptation au changement climatique.
L’avenir de la souveraineté sur les ressources en haute mer dépendra largement de l’évolution de ces équilibres géopolitiques. La tendance à la fragmentation du système international pourrait compromettre l’efficacité des mécanismes multilatéraux de gouvernance océanique. À l’inverse, la prise de conscience des interdépendances écologiques pourrait favoriser l’émergence d’un nouveau multilatéralisme maritime.
Les technologies de surveillance et de contrôle transforment profondément les modalités d’exercice de la souveraineté en mer. Les systèmes d’identification automatique des navires, l’imagerie satellitaire et l’intelligence artificielle permettent une transparence accrue des activités maritimes. Ces technologies peuvent servir tant la coopération internationale que l’affirmation unilatérale de puissance.
Perspectives futures : vers un nouveau contrat social océanique?
L’avenir de la souveraineté sur les ressources en haute mer se dessine à la croisée de tendances contradictoires. D’un côté, l’intensification des pressions économiques et l’affirmation des puissances maritimes pourraient conduire à une fragmentation accrue des espaces océaniques. De l’autre, l’urgence écologique et les avancées du droit international maritime ouvrent la voie à des formes innovantes de gouvernance partagée.
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Un premier scénario, qualifié de « mare clausum » (mer fermée), verrait la multiplication des revendications nationales et l’extension progressive des juridictions étatiques au détriment des espaces communs. Ce scénario s’inscrit dans la tendance historique longue d’appropriation des espaces maritimes, mais se heurte aux limites physiques de l’exercice de la souveraineté en haute mer.
Un deuxième scénario, dit de « mare liberum » (mer libre), maintiendrait le principe de liberté en haute mer tout en renforçant les mécanismes de coopération internationale pour la gestion durable des ressources communes. Le traité BBNJ s’inscrit dans cette perspective, mais son efficacité dépendra de sa mise en œuvre effective et de l’engagement réel des États.
Innovations conceptuelles et juridiques
Face aux défis contemporains, de nouveaux concepts juridiques émergent. La notion de « souveraineté fonctionnelle », distincte de la souveraineté territoriale classique, pourrait offrir un cadre conceptuel adapté aux spécificités des espaces maritimes. Elle reconnaîtrait des droits et responsabilités différenciés selon les fonctions écologiques, économiques ou culturelles des écosystèmes marins.
Le concept de « fidéicommis planétaire » (planetary trust), développé par des juristes comme Edith Brown Weiss, propose une vision intergénérationnelle de la gestion des ressources communes. Il impliquerait la reconnaissance d’obligations envers les générations futures dans l’exploitation des ressources marines.
Ces innovations conceptuelles s’accompagnent d’évolutions dans les pratiques de gouvernance. L’approche par écosystème transcende les frontières juridiques traditionnelles pour appréhender les réalités écologiques dans leur complexité. La planification spatiale marine en haute mer permettrait d’organiser rationnellement la coexistence d’usages multiples.
- Développement de mécanismes de compensation écologique
- Extension du principe pollueur-payeur aux espaces internationaux
- Reconnaissance de droits à la nature marine
- Intégration des savoirs traditionnels dans la gouvernance océanique
Un véritable « contrat social océanique » reste à inventer. Il impliquerait un nouvel équilibre entre souveraineté nationale et responsabilité collective, entre valorisation économique et préservation environnementale. Ce contrat devrait reconnaître la spécificité des écosystèmes marins, caractérisés par leur fluidité, leur connectivité et leur tridimensionnalité.
La haute mer, dernier grand espace commun de la planète, constitue un laboratoire pour repenser les modalités de gouvernance des ressources partagées à l’ère de l’Anthropocène. Les choix effectués dans les prochaines décennies détermineront non seulement l’avenir des océans, mais aussi notre capacité collective à gérer durablement les communs planétaires.
